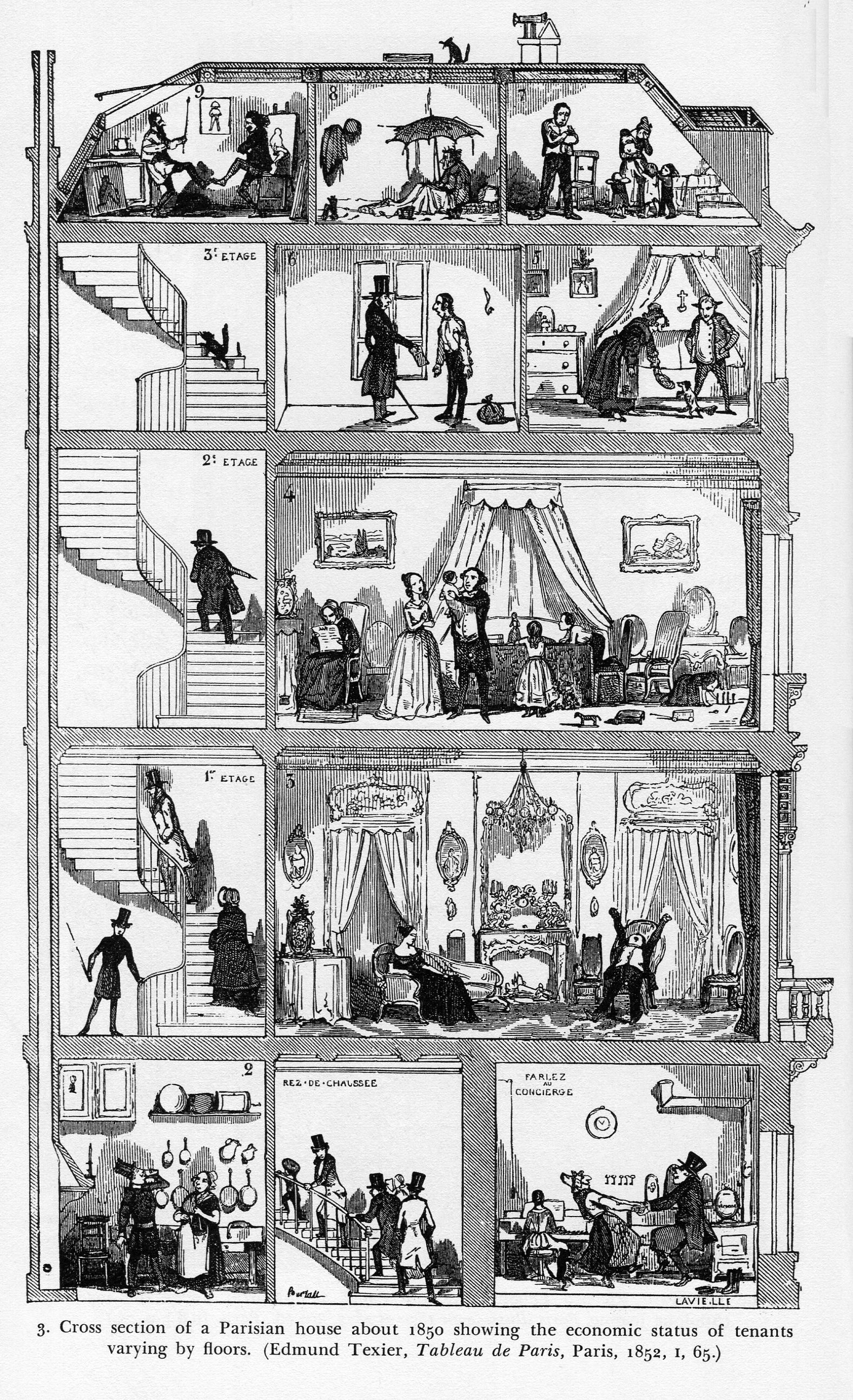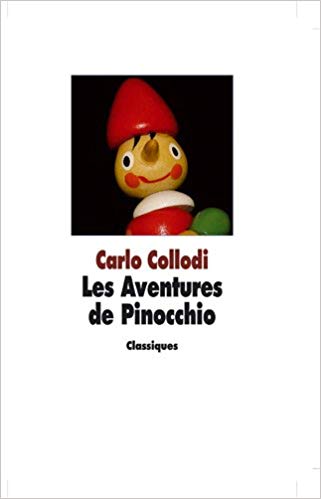La terre d’Émile Zola, 1887

♬ Dans la terre, quand tombe un grain de blé
C’est l’espoir qui va bientôt germer
Au sillon, il vient s’abriter
Il attend les beaux jours de l’été… ♬
Je poursuis mon chemin dans ce cycle des Rougon-Macquart, et suis une fois de plus émerveillée par le talent d’Émile Zola et par le travail colossal qu’a dû représenter la rédaction de cette oeuvre magistrale.
Chaque volume nous fait découvrir un nouvel univers et ce quinzième, dans l’ordre chronologique de rédaction, nous plonge dans la vie des paysans.
Si l’on a déjà lu Zola, on imagine sans peine en entamant cette lecture qu’il va nous offrir de ces magnifiques descriptions dont il a le secret.
Et c’est effectivement le cas.
Les paysages sont présentés de façon flamboyante et la Beauce est enchanteresse sous la plume de l’auteur, qui nous fait ressentir toute la force de l’expression « terre nourricière ».
Dans ces champs dans lesquels pousse le blé s’exerce une activité vitale. Il ne s’agit pas de jardinage ou de culture d’agrément : la vie des hommes dépend entièrement des récoltes.
(Petite parenthèse : quand j’écris « hommes » je parle bien évidemment des hommes ET des femmes.
Cela va sans dire ou plutôt, cela allait sans dire jusqu’à un passé assez récent, jusqu’à ce qu’un vent de folie stupide se mette à souffler, entretenu et amplifié par certaines personnes qui se pensent « in » ou « modernes » et voudraient soumettre toute la société au diktat de leur bienpensance.
Je refuse ces crétineries de toutes mes forces et n’écrirai jamais le lourdingue et superflu « tous les hommes et toutes les femmes », je n’utiliserai jamais les points qui rendent tout illisible alors qu’ils se prétendent inclusifs, je n’emploierai jamais la tristement célèbre formule, grammaticalement fautive qui plus est, « toutes celles et ceux » popularisée par un paon arrogant.
Voilà, c’est précisé, et tant pis pour les grincheux qui n’apprécieraient pas : je me contrefiche de votre avis.
Donc je persiste : la vie des hommes dépend entièrement des récoltes.
Fin de la parenthèse.)
Tel un peintre, Émile Zola nous montre les paysans au travail, la noblesse et la rudesse du labeur à une époque qui ne connaît pas encore la mécanisation et où tout se fait à la force du poignet.
Les récoltes, le battage du blé dans des gestes répétés et précis – savoir-faire transmis de génération en génération − toutes les étapes du travail agricole y passent, le tableau le plus sublime étant (à mon avis) celui des semailles.
Pour l’écrivain, le geste du semeur est une allégorie de la vie tant cette étape initiale est cruciale : tout doit être fait de la façon la plus parfaite possible afin d’assurer le succès vital de la récolte à venir.
On comprend que n’est pas du blé qui est semé : ce sont des germes de vie dans un mouvement ancestral qui féconde la terre.
Que c’est beau !
Moi qui aime tant les descriptions de Zola, toutes ces pages m’ont enchantée mais si je m’arrêtais là, vous pourriez croire que ce roman n’est qu’une longue promenade bucolique à travers la Beauce.
Comme ce serait réducteur !
Zola a dépeint la nature et parsemé son livre de scènes agricoles pour suivre le fil des saisons et donner un cadre à une histoire étourdissante.
Il a donné vie à des personnages aux caractères bien affirmés, que les difficultés du quotidien ont endurcis.
Certains sont détestables, d’autres émouvants comme le vieux Fouan usé par les ans et qui a dû à contrecoeur céder ses terres.
Ce pauvre vieillard se sent désormais inutile ou plutôt, on lui fait sentir son inutilité et l’on n’est pas tendre avec lui : ses propres enfants lui font comprendre qu’il est désormais un poids, un fardeau. Une bouche inutile.
Jugez plutôt :
« Des gens passaient qui ne le saluaient plus, car il devenait une chose. Sa pipe même lui était une fatigue, il cessait de fumer, tant elle pesait à ses gencives, sans compter que le gros travail de la bourrer et de l’allumer, l’épuisait. Il avait l’unique désir de ne pas bouger de place, glacé, grelottant, dès qu’il remuait, sous l’ardent soleil de midi. C’était, après la volonté et l’autorité mortes, la déchéance dernière, une vieille bête souffrant, dans son abandon, la misère d’avoir vécu une existence d’homme. D’ailleurs, il ne se plaignait point, fait à cette idée du cheval fourbu, qui a servi et qu’on abat, quand il mange inutilement son avoine. Un vieux, ça ne sert à rien et ça coûte. Lui-même avait souhaité la fin de son père. Si, à leur tour, ses enfants désiraient la sienne, il n’en ressentait ni étonnement ni chagrin. Ça devait être. »
Comment ne pas être bouleversé ?
Et ceci n’est qu’un exemple de la cruauté et de la noirceur de ce tome, le plus noir de tous ceux que j’ai lus jusqu’à présent dans ce cycle époustouflant.
La terre, précieuse par-dessus tout, est plus précieuse que l’amour.
Personnage à part entière de l’histoire, voire personnage principal, c’est elle qui dicte tout. D’elle dépendent les hommes qui y vivent et y travaillent.
C’est elle qui aura toujours le dernier mot.
Mais ce qui pourrait engendrer amour et respect fait naître aussi des jalousies extrêmes et de la cupidité à un point terrifiant dans leurs conséquences.
Émile Zola a conçu un scénario terriblement féroce et violent !
Germinal était déjà empreint de violence mais celle-ci était principalement exercée sur les mineurs et leurs proches par les exploitants de la mine. Deux milieux sociaux s’affrontaient tandis qu’ici, on s’entredévore et l’on se hait entre semblables, et même entre membres d’une même famille.
C’est une violence monstrueuse et barbare, d’une autre nature et encore plus inacceptable.
On pourrait penser que, vivant dans la difficulté, les paysans s’entraideraient, mais c’est tout le contraire : voilà pourquoi j’ai trouvé ce livre si dur.
Choquant au sens premier du terme. Ébranlant.
Émile Zola a rédigé un texte non seulement violent mais aussi très cru et d’une incroyable intensité.
L’atmosphère est parfois terriblement brutale et l’auteur se plaît à montrer les similitudes qu’il y a souvent entre hommes et bêtes.
Dans une formidable scène d’accouchements simultanés d’une femme et d’une vache, il nous renvoie sans ménagement à notre condition animale.
Ce passage est vraiment cocasse et fait partie des touches d’humour glissées de-ci de-là, comme pour mieux faire passer la noirceur générale.
L’ensemble donne un roman plein de vie, prenant et haletant, que j’ai refermé le souffle coupé.
Du grand Zola. Du très grand Zola !